L’imagination vit de la recherche des atmosphères, ambiances et climats que l’on trouve dans la musique comme dans n’importe quel art – quel intérêt présenterait une expression créatrice si elle ne stimulait pas l’imagination, l’évasion, la recherche d’un ailleurs ou d’un au-delà de la trivialité, de la routine quotidienne et de ses médiocrités ? Ce sont les portes qu’ouvre la science fiction. Cet article présente quelques pistes et sentiers de voyage, d’exploration intérieure, découvertes et spéculations prospectives et utopiques sur les lignes de fuite de ce que le présent recèle déjà, ou manières de s’en détourner par les fenêtres ou portails qu’ouvre la création littéraire.
Il s’agit ici de présentations, de simples regards et indications, notes de lecture organisées en deux thématiques : spéculations et métaphores du présent, rassemblées dans la catégorie de la science fiction, ou chemins de l’ailleurs et de l’au delà dans les univers du fantastique et de la fantasy.
- Greg Bear : Eon,Éternité, La cité à la fin des temps, L’échelle de Darwin
- Robert J. Sawyer – WWW Trilogie
- Joan D. Vinge – La reine des neiges
- Hugh Howey – Silo
- Charles Stross – Aube d’acier / Crépuscule d’acier
- Olaf Stapledon – Rien qu’un surhomme, Créateur d’étoiles
- Robert Charles Wilson – Les derniers jours du Paradis, Les Perséïdes
- Connie Willis – Le Grand Livre
- Jack Mc Devitt – Seeker
- Gregory Benford – Le Cycle du Centre Galactique
Greg Bear – Eon (1985)
Roman complexe et riche, foisonnant de personnages, de lieux et d’imaginaire technologique aux frontières de la métaphysique, Eon est le premier volume du dyptique de la Voie.
Un gigantesque artefact vient se placer en orbite autour de la terre, mais il semble bien que nous en soyons les créateurs. Vient-il de l’avenir ? D’un univers parallèle ? Y a t il des savants et chercheurs contemporains qui pourraient le comprendre, si ce n’est avoir été à son origine dans un futur encore proche de nous ? Car cet immense vaisseau est désert, vidé de ses habitants mais non de ses villes, bien qu’il semble subsister un chemin clair pour suivre les constructeurs : la Voie, infinie, qui s’ouvre dans la dernière chambre…
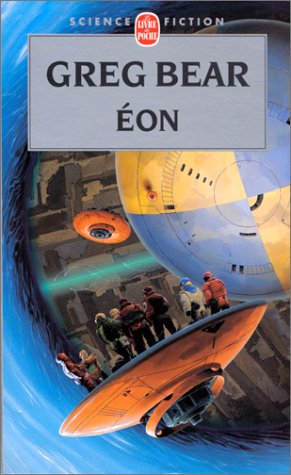
La lecture d’un texte devenu uchronique est curieuse. Datant du milieu des années 80, Eon met en scène une survivance du bloc de l’Est autour des années 2000, mais si Greg Bear n’est tendre avec aucun des deux camps, l’essentiel est ailleurs : le devenir de l’humain. Certes, le roman déplore les possibilités d’auto-destruction dont nous disposons et qui n’ont besoin que d’un alibi politique pour éclater en guerre et destruction totales, de nous mêmes comme de la planète. Mais le roman ne s’enferme pas dans les difficultés de la survie post apocalyptique et la continuité de la violence qui en découlent, même si la société complexe de ce futur lointain résulte de cette destruction planétaire. En effet, les spéculations sur l’immortalité offertes par les technologies de stockage et matrice de personnalité au-delà de la mort corporelle sont pleinement actuelles dans le contexte du transhumanisme que connaît déjà bien l’auteur. Que devons nous faire de notre technologie qui est déjà là et va nous transformer inéluctablement, même si nous demeurerons politiquement divisés sur son statut, y compris dans la manière dont elle définira notre rapport à notre corps ? Greg Bear met aussi en scène les idées de Ralph Nader, au cœur des clivages politiques d’une cité qui préfigure déjà celle de « la fin des temps », son grand ouvrage ultérieur.
Les spéculations technologiques se poursuivent et trouvent un écho dans des œuvres plus récentes comme « Rainbows End » de Vernor Vinge : pourquoi continuer à décorer et meubler un appartement, voire un complexe d’habitations ou toute une ville, avec des objets réels, dès lors que nous pouvons projeter quasiment tout ce que nous souhaitons sur des murs conçus à cet effet, y compris des icônes pouvant remplacer des contacteurs électriques ? Il suffit de toucher ces icônes sur un mur pour que l’intelligence artificielle domotique règle l’éclairage, la température ou encore d’autres paramètres environnementaux… On pense aux décors muraux envisagés par Philip K Dick, auxquels sont adjoints des implants cérébraux qui font croire en leur réalité (le film Total Recall en donne une illustration). Greg Bear en donne une représentation plus réaliste et moins aliénante, bien au-delà d’un simple décor pour agrémenter un cadre de vie quotidien.
Les habitants de l’utopie au bout de la Voie ne se contentent pas de domotique qui fait exploser les frontières du virtuel et du réel d’une manière encore plus vraisemblable aujourd’hui que lors de la rédaction de ce roman (on pense aussi à la mise au point des premiers vêtements connectés dont parlait Vernor Vinge dans le roman Rainbows End déjà cité). Le rapport au langage et par là à autrui se trouve profondément modifié par les ensemble d’icônes dont s’entourent les personnages pour communiquer, comme un nuage d’images toutes pleinement signifiantes exprimant nuances, états émotionnels et appartenances tribales souvent plus importantes que ce que les personnages ont à dire à voix haute. Encore faut-il disposer de ce petit appareillage personnel permettant de picter de telles icônes, mais rien de tout cela ne pose de problème dans cette société utopique d’extrême abondance. On pourra cependant s’interroger sur la représentation que donne l’auteur de l’apprentissage des langues étrangères, qui ne demande que quelques heures au moyen des technologies du futur…
Greg Bear – Éternité (1988)
La suite de Eon présente toujours cette finesse très appréciable d’échapper à la facilité des descriptions fastidieuses de la violence post apocalyptique, thème hélas de plus en plus envahissant de l’imaginaire de la science fiction depuis 15 ans.Sans dévoiler davantage l’intrigue de ces deux romans, il est clair que l’utopie a une histoire comme des ennemis, qu’elle est face a des tournants comme des responsabilités qui ne font pas l’unanimité dans une communauté et une cité qui se trouvent dans le présent et l’histoire – c’est à dire, pour le lecteur, l’avenir devenu uchronique du conflit Est – Ouest. Si le roman est devenu uchronique, il l’était de toute manière déjà à sa publication puisque toute une partie de l’histoire se déroule dans un univers dont l’histoire a dévié du notre depuis la mort d’Alexandre le Grand – les amateurs de Steampunk pourront peut être y trouver leurs thèmes de prédilection dans la description d’un univers étrange, menacé par des conquérants très éloignés dans le temps et l’espace que des portails dimensionnels abolissent, mais très éloignés aussi de tout ce que nous pouvons appeler humain bien au-delà de l’apparence corporelle. Greg Bear nous propose une forme de Space Opera sans vaisseau spatial (qui n’est pas sans lien avec la série Stargate), mais l’enjeu n’est plus l’héritage d’un lointain passé mais bien le contact avec un futur plus éloigné encore dans le temps que la cité utopique ne l’est dans l’espace du bout de la Voie.
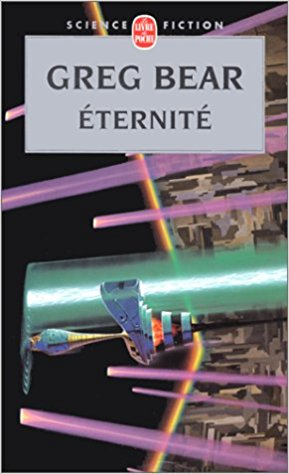
En effet, une réflexion sur l’humain et le mouvement par lequel il se transcende lui même se déploie en toile de fond de l’intrique de ce second roman, l’auteur y exprimant son admiration pour les thèmes chers à Olaf Stapledon et la méditation sur la fin des temps, le confluent des lignes de fuite, des horizons et des recoupements des parallèles à l’infini.
Double roman ambitieux, Eon / Eternité pousse très loin l’articulation des spéculations politiques, technologiques, scientifiques et métaphysiques dans la construction d’un univers foisonnant de lieux, époques et personnages qui cherche une vraisemblance en s’enracinant dans les développements de la physique contemporaine. Les véritables enjeux sont toutefois ailleurs, dans une méditation métaphysique sur la nature de l’humain et ce qui peut en subsister au-delà de l’attachement au corps tel que nous le connaissons. Dans cette construction transhumaniste aux enjeux métaphysiques, Greg Bear peut dérouter et parfois perdre son lecteur, mais il sait toujours tenir compte de la dimension affective de la personne et de la vie de ses personnages en construisant une histoire qui sait tenir en haleine tout en mettant en scène des constructions spéculatives lointaines et ambitieuses.
Greg Bear – La cité à la fin des temps (2008)
Ce texte très complexe est d’abord un roman s’ouvrant sur un monde sombre et intrigant, très proche du nôtre au départ, dont les personnages vivent des destins dont on attend le croisement dans le cours d’une narration qui dévoile rapidement des enjeux métaphysiques, dont cette Cité de la fin des temps que des romans antérieurs de l’auteur préfiguraient déjà. Sans dissoudre le récit dans la spéculation philosophique, Greg Bear sait nous raconter une histoire présentant des personnages complexes, vraisemblables, mais de plus en plus manipulés par leur destin, ou leur nature profonde, en tout cas par des forces qui les transcendent et manipulent de plus en plus profondément la réalité. Celle-ci s’altère, se dégrade, se contracte et fait passer de l’histoire de quelques personnes très étranges à une histoire du futur qui est seulement partiellement rapportée, ce qui lui donne toute la profondeur de ce qui n’est que suggéré. La réalité a une fin, un terme comme un ennemi bien différent du vilain sorcier noir démesurément puissant de très nombreux romans de fantasy. Insensiblement, on s’achemine de la méchanceté et de la violence à l’emprise croissante du néant qui se referme sur l’univers et qui rend le temps lui même dénué de réalité, car tous les enjeux se situent au bout de la route. Les univers et destins croisés du départ prennent toute leur signification dans l’unité et le cœur de la réalité : la sphère armillaire, comme la fin de l’utopie se trouvant à l’infini, à la rencontre des parallèles, figurations métaphysiques que Greg Bear sait nous présenter avec ses spéculations vertigineuses.

Dans cette construction déroutante, l’auteur nous emmène au-delà de la science fiction (y a-t-il d’ailleurs une quelconque spéculation technologique ou scientifique dans ce texte, à la racine de la construction de son univers ?) dans une altération de la littérature utopique dont le sens n’a plus grand chose de politique. Mais on trouve toujours des descriptions savamment distillées de cette société close comme et de sa très ancienne architecture titanesque. Le voyage et l’exploration d’un univers dangereux sont encore bien présents, mais il ne s’agit plus de la recherche d’un eldorado perdu : l’utopie est maintenant placée au cœur de la métaphysique dans un univers d’autant plus totalitaire que l’humanité est devenue elle même une forme de manipulation technologique. L’avenir est tellement lointain qu’on attend plus guère d’explication quand aux machines étranges et lieux improbables qui supplantent peu à peu le dernier refuge du fugitif au début du récit : une gigantesque et mystérieuse bibliothèque.
A la fois roman et traité de métaphysique pas toujours facile à poursuivre, La cité à la fin des temps bouscule considérablement les genres de la science fiction, du récit utopique, du conte philosophique et de la spéculation sur les ultimes destinées de l’humanité dans la continuité de l’œuvre d’Olaf Stapledon, mais de manière certainement beaucoup plus convaincante du point de vue de la construction narrative et imaginaire. Continuité ou transfiguration de la littérature utopique dont vient la science fiction ? Œuvre en tout cas majeure.
Greg Bear – L’échelle de Darwin (1999)
Des paléontologues cupides et maladroits découvrent dans la montagne les restes d’une étrange famille néandertalienne avec un enfant qui semble moderne dans un état de conservation exceptionnel. Leur maladresse cause la prolifération d’une épidémie foudroyante qui ressemble à une grippe (on ne peut s’empêcher de penser au début du Fléau de Stephen King). Celle-ci touche uniquement les femmes et provoque des fausses couches, puis la formation d’un nouveau fœtus alors que la malade se remet difficilement. Est-ce l’aube d’une nouvelle humanité, signifiant la fin de notre espèce telle que nous la connaissons ? Greg Bear place le problème de l’évolution de l’homme au coeur de ses romans. Dans « L’Echelle de Darwin », le thème n’est plus métaphysique mais génétique, avec une base biologique très solide dans un roman qui peut se dévorer comme un thriller policier.
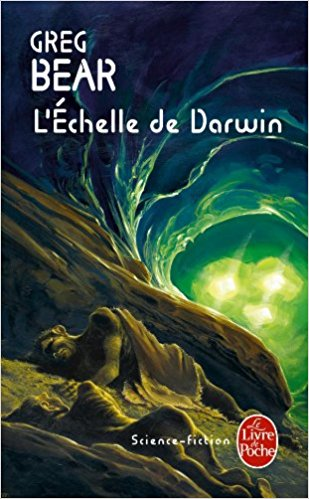
Des allers et retours avec un passé immémorial ponctuent le récit captivant d’une généticienne du CDC concernée au premier plan par les risques de contagion. Les réflexions sur la nature de l’évolution questionnent les notions de Darwinisme et de finalité de la vie de manière originale, sans que l’auteur prenne position ou abandonne ce que l’on sait de la nature de la vie. Un tel questionnement prolonge l’interrogation sur la nature profonde de l’homme et la possibilité d’une amélioration de son espèce, voire d’une destination, dans la mesure où la science donne aujourd’hui la matière à une réflexion qui est restée longtemps confinée dans les domaines de la métaphysique. Greg Bear donne élégamment à son lecteur les moyens de cette réflexion, sans lui imposer aucune conclusion.
Robert J. Sawyer – Trilogie de la singularité
Eveil – Veille – Merveille (2009 – 2011)
L’optimisme et la gentillesse sont des qualités humaines d’autant plus appréciables qu’elles sont peut être trop rares, en particulier dans les univers sombres et violents voire macabres omniprésents dans la science fiction de toutes les époques, des Morlocks de H.G Wells aux cavernes d’acier de Terminator. Il est vrai que la réflexion sur l’avenir dans une tradition contre – utopique ne prête guère à l’optimisme béat devant des lendemains qui chantent ou la gentillesse des hommes, la science fiction cherchant la plupart du temps à dénoncer les mensonges et pièges derrière de tels univers.

Robert J. Sawyer prend ici le contre pied de toute cette noirceur dans une trilogie qui met en parallèle l’éveil au monde, aux autres et à l’age adulte d’une jeune aveugle, et l’éveil à la conscience d’une intelligence artificielle dont la puissance en croissance exponentielle va nécessairement changer le monde au fur et à mesure de son interaction nécessaire avec lui. L’écriture fluide et le cours très solide et vraisemblable des événements rendent la lecture de cette trilogie agréable. On est immergé dans des références à la culture geek qui pénètre notre quotidien de plus en plus, au travers des réseaux sociaux en particulier, avec une érudition technologique irréprochable, même avec le recul de quelques années. Peut être l’investissement dans ces romans de personnalités de premier plan dans le développement d’internet à l’échelle planétaire comme dans le transhumanisme ajoute-t-il encore du crédit à une œuvre tout à faire reconnue.
Mais peut-on réellement rester aussi optimiste devant l’imprévisibilité de la croissance exponentielle de la puissance de l’intelligence artificielle ? On ne peut parler de singularité technologique, d’un moment rendant l’avenir imprévisible, dans la dimension strictement individuelle d’un ordinateur devenant conscient et se mesurant au grand méchant gouvernement américain. Les questions de l’automatisation de la société, inséparables de la singularité car c’en est le fondement, sont évacués totalement d’un récit qui ne fait une allusion remarquée au cyberpunk que pour en évacuer toute noirceur. On peut comprendre l’intérêt des dirigeants de Google pour un message aussi rassurant sinon lénifiant. Toutefois, l’idée selon laquelle une telle intelligence artificielle, totalement dépendante de l’infrastructure matérielle du réseau informatique terrestre, ne peut quitter notre planète, est intéressante. C’est regrettable, car si cette IA avait pu partir a la conquête de l’espace, elle serait certainement parvenue à transformer de méchants aliens en gentils bisounours.
Joan D. Vinge – La reine des neiges (1980)
La science fiction au tournant des années 80 connaît des mutations thématiques qui donneront lieu à des oeuvres majeures, comme le cycle de Teur de Gene Wolfe ou l’univers de Majipoor de Robert Silverberg : large abandon des spéculations technologiques, incursions de plus en plus poussées vers les univers de l’héroic fantasy, même si la science fiction demeure bien présente au moins dans une certaine conscience collective de la nature de l’univers et de la réalité du voyage spatial.
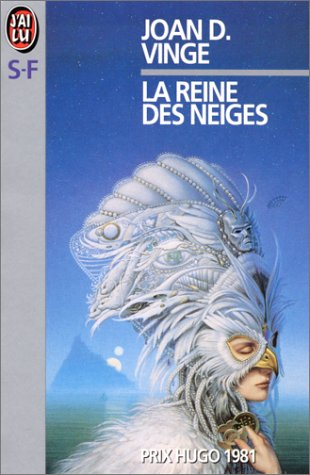
Ce roman de Joan D. Vinge, prix Hugo 1981, est un excellent roman d’aventures sur le thème d’une civilisation galactique très lointaine. Une société presque privée de vaisseaux spatiaux a un mode de vie aux éléments fortement médiévaux voire primitifs, technologiquement comme politiquement. L’imbrication de divers stades de développement donne à cet univers son originalité, jusque dans l’architecture grandiose et contrastée de la capitale, le palais royal semblant magique en raison des technologies futuristes qui le sous tendent, avec à ses pieds une humanité foisonnante et complexe dans un dédale médiéval de ruelles et boutiques chamarrées. Une reine tyrannique choisit de se cloner elle même pour assurer sa survie au delà d’un changement social et politique radical induit par le changement climatique que l’orbite très lente de la planète impose. La fin périodique de la période glaciaire signifie en effet le retour au pouvoir de toute une partie de l’humanité de cette planète exilée. On assiste alors aux modifications traditionnelles d’un système social et politique quasiment féodal dont sont spectateurs les dignitaires d’un empire galactique qui ne surmonte plus les immenses décalages temporels des voyages spatiaux à la suite d’une lointaine guerre interstellaire ayant conduit l’humanité à la dispersion.
Les éléments ethnologiques du roman sont inscrits et présentés dans le parcours de ce clone, Moon, qui se découvre elle même et l’univers dans la quête d’un amant voué à se perdre dans les jeux de pouvoir de la cour de la Reine de Neiges. Un des ressorts principaux de l’intrigue nous fait attendre les retrouvailles de ces amants adolescents après tous les changements que la vie et l’aventure leur ont imposés, ce qui est assez classique mais jamais mièvre. Cependant, la richesse de ce monde noie hélas quelque peu l’exploration ethnologique de ses sociétés et cultures, Ursula Le Guin par exemple menant beaucoup plus loin l’exploration d’humanités imaginaires dans des romans pourtant plus brefs. Mais Joan D Vinge parvient toutefois à maintenir l’intérêt de son lecteur avec une intrigue très bien menée qui ne s’attarde jamais dans les descriptions de cultures tout de même bien étudiées dans leur richesse et leur complexité.
Hugh Howey – Silo (2011 – 2013)
Percevoir la réalité au travers d’un écran est récemment devenue la vie de beaucoup de gens… Philip K. Dick a traité ce thème dans son roman La vérité avant dernière (1964), dont le double enjeu est l’enfermement de l’humanité entière dans une dystopie souterraine concentrationnaire et le maintien d’un tel enfermement par le mensonge médiatique orchestré et entretenu par la rare part de l’humanité qui demeure hors de ces cavernes d’acier et passe sa vie a entretenir ce mensonge : « continuez à travailler pour soutenir l’effort de guerre, le sort de l’humanité et de notre civilisation dépend de votre travail même si le monde extérieur, totalement irradié, n’est plus viable ». Contrairement à d’autres textes de Dick, les clefs du mensonge comme de la réalité nous sont données assez rapidement dans un récit dont l’enjeu est plus politique que métaphysique.

Hugh Howey reprend ces thèmes dans la trilogie Silo, dont les trois tomes s’enchaînent et doivent être lus à la suite. On retrouve les éléments de l’univers concentrationnaire, de la contre utopie, tels que de nombreux romans du XX° siècle semblent ne les avoir pourtant pas épuisés, tant on prend plaisir à découvrir cet univers sombre, cette humanité enfermée et confinée qui ne sait même plus ce qu’est marcher droit devant soi, en ligne droite. Le monde est circulaire, ses stratifications sociales se parcourent par d’interminables escaliers qui relient les divers niveaux du silo, qui sont les niveaux de la société. Bien sûr, les hommes ont intériorisé les raisons de leur enfermement comme la chape de plomb de la domination tyrannique qui pèse sur eux. Ils ont aussi intégré la peine capitale qui attend tout esprit subversif : être condamné à sortir ! Voir ce qu’il y a derrière l’écran géant qui montre un monde mort, désolé, irradié, alors que nul n’a plus conscience des causes qui ont détruit le monde dont on ne se représente même plus clairement la véritable nature. Dans cet univers, les hommes ont perdu toute représentation claire de ce que sont les étoiles et même le ciel, comme le passé et l’histoire dont le souvenir est mortel pour la société. Le condamné à mort, exclu sans retour, aura pour tâche de nettoyer cet écran, ce que les machines du silo ne peuvent faire. L’aliénation est telle que chaque condamné le fera de bonne grâce avant de profiter de ses quelques instants de vie dehors, à la découverte d’une vérité qu’il pense très différente de ce qu’on lui a toujours enseigné.
Pourquoi le monde est-il inhabitable ? L’est-il vraiment ? Qu’y a-t-il dehors ? Quelles sont les strates de mensonge empilées derrière l’écran et surtout dans les consciences des acteurs de la dystopie, de ceux qui doivent bien, quelque part, tirer les ficelles du monde ? Le redoublement de ces mensonges constitue le cœur de l’intrigue de ces trois romans. Des tromperies monstrueuses reviennent chaque fois que l’on pense avoir les clefs de cet univers et de ce qui a bien pu se produire pour qu’il ne reste que ce petit échantillon d’humanité enfermé dans ce minuscule sous sol cylindrique qui devient le monde de générations qui s’enchaînent, dans la quête invisible et le voyage immobile d’une société qui, malgré tout, fonctionne.
Dans bien d’autres romans dystopiques, on s’attend à découvrir le parcours d’un seul personnage principal qui soulève le voile des mensonges, du totalitarisme dont le discours fait totalement écran devant le monde, la vie, la terre, le ciel, l’herbe, les oiseaux. Silo nous montre par contraste le double parcours de la victime comme du bourreau à travers un écheveau de voiles de fumées toxiques dont on se protège avec un énorme jet d’azote purifiant avant de sortir, en combinaison protectrice méticuleusement fabriquée dans les ateliers souterrains. Tout et tous sont enfermés dans le mensonge et l’aliénation comme le programme de son maintien et de sa maintenance, même ceux qui ont tout organisé dans un contexte politique qui, pas plus que celui du roman de Philip K. Dick, n’a plus la moindre importance après une telle durée d’enfermement qui est peut-être elle même mensongère.
Qu’y a-t-il derrière nos écrans et le monde qu’ils nous donnent à voir, dans la précision et l’accumulation d’informations aux multiples sources concernant une réalité à laquelle nous n’avons pas accès dans notre quotidien ? La trilogie de Hugh Howey constitue une métaphore magistrale et passionnante du tissu de mensonges impalpable mais bien solide qui a remplacé notre rapport au monde en le plaçant derrière un écran.
Depuis la rédaction première de cet article, une adaptation de cette trilogie en série télévisée est en cours de diffusion (2015).
Charles Stross – Crépuscule d’Acier (2003) / Aube d’Acier (2004)
La singularité technologique change tout, même la science fiction qui devient elle aussi imprédictible. Ainsi, les invasions extraterrestres prennent maintenant la forme de pluie de téléphones portables qui peuvent exaucer tous vos vœux, même vous fournir une corne d’abondance, à condition de les distraire. Le combat spatial entre gigantesques vaisseaux armés de canons démesurément prétentieux est totalement obsolète, de tels vaisseaux étant cannibalisés par des agents furtifs qui vont commencer par pirater leur réseau informatique. La terre a connu des évolutions politiques notables : l’unité de souveraineté, par exemple le membre de l’ONU, n’est plus l’Etat Nation mais l’individu lui même. Et les ordinateurs et Intelligences Artificielles dans tout ça ? D’abord, quoi qu’on en pense, ils ne sont pas divins. Mais ce qui en reste et qu’on peut en connaître est extrêmement méfiant sur le sujet, en particulier vis à vis de ceux qui cherchent à provoquer des paradoxes temporels, même en douce. Bien sûr, il subsistera toujours des dictatures rétrogrades pratiquant la censure et limitant la liberté d’expression – on pourrait d’ailleurs confondre censure et panne des communications, avec un peu de recul, par exemple celui d’une intelligence artificielle ayant évolué dans l’espace pendant des millions d’années.
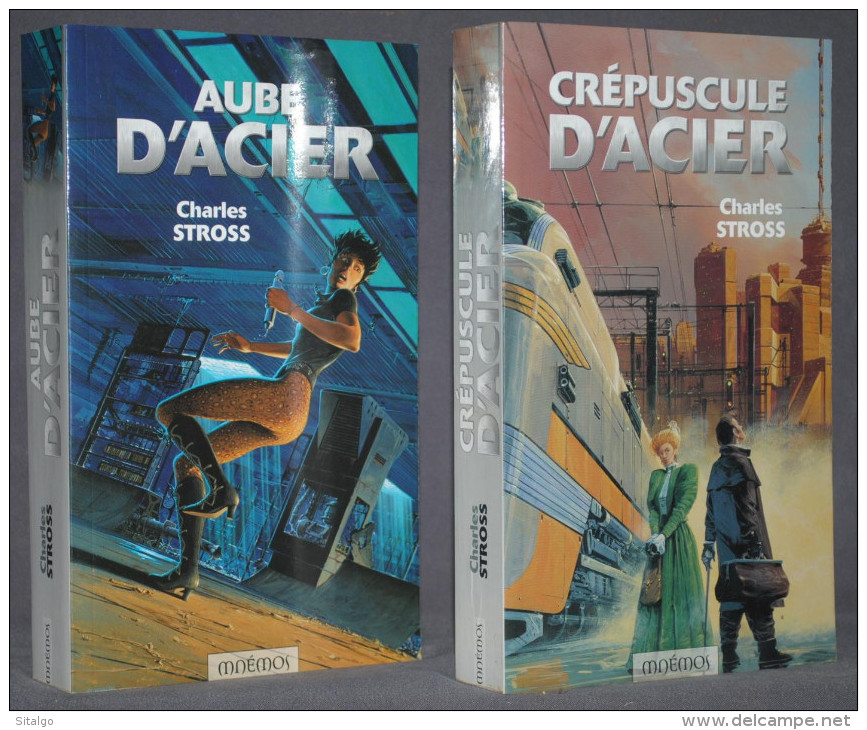
Ces deux romans de Charles Stross dépeignent un univers de spéculations souvent très drôles mais en même temps tellement cohérentes, dans la continuité de ce ballon que conçoit Vernor Vinge dans La Captive du Temps Perdu qui allait déjà plus loin que les vêtements connectés ou les voitures automatiques du plus récent Rainbows End. En un sens, c’est de la SF traditionnelle dont Charles Stross s’empare, il nous montre des formes devenues obsolètes à force de s’être installées dans un imaginaire devenu trop habituel et facile, on penserait par exemple aux différences sur le fond assez peu sensibles entre les vaisseaux spatiaux de Star Trek et ceux de Stargate, au delà de leurs formes. Stross les traite comme de vieux tacots poussifs.
On peut difficilement nier le succès de son entreprise dans Crépuscule d’Acier qui nous raconte une histoire parsemée de toutes ces inventions, nouveaux vaisseaux spatiaux et évolutions sociales qui posent un univers très original dans sa continuité avec le space opera. Il ne s’agit pas de renouveler radicalement le genre, mais d’ouvrir de nouveaux horizons spéculatifs au lecteur à partir de ce qu’il a déjà lu, comme des évolutions technologiques les plus récentes. Le second roman, Aube d’Acier, laisse un sentiment plus mitigé. L’univers est posé, on ne fait qu’en approfondir les détails dans la trame d’une aventure certes pleine de rebondissements, mais qui souffre de certaines longueurs et montre un modèle qui commence à s’essouffler. Si ce texte mérite le détour, on appréciera la volonté de Charles Stross de ne pas poursuivre cet univers par un troisième roman..
Charles Stross Palimpseste (2010)
(Hugo 2010 de la meilleure nouvelle)
Que donne la maîtrise radicale du voyage dans le temps conjuguée à la possibilité de remodeler comme nous le souhaitons notre environnement ? Des agents extraits du cours de la temporalité qui commencent par tuer leur propre grand père peuvent modeler un futur très lointain en déplaçant des échantillons de population pour recommencer une civilisation des millions d’années dans le futur, au delà de changements climatiques et de cataclysmes qui n’ont plus d’importance. Mais malgré toutes les manipulations des souvenirs, deux personnalités ne peuvent-elles pas se maintenir par l’amour ?
Un texte court, à l’histoire conçue pour cette brièveté. Charles Stross part de quelques prémisses de spéculation technologique qu’il pousse très loin de manière tout à fait cohérente, jusqu’à la construction d’une sphère de Dyson, une ingénierie radicalement mégalomane qui s’étend à l’échelle du système solaire. La dimension humaine n’est pas oubliée avec des personnages solidement campés à l’intérieur d’un univers très complexe, mais qui n’en deviennent pas pour autant des carcasses vides de contenu personnel. Tout ce court roman exprime ainsi un parcours de réelle souffrance personnelle qui met bien en lumière ce que l’on perd à changer le passé : une vie humaine dans toute sa richesse. Autre manière de dire que ce texte nous raconte une vraie histoire que l’on éprouve un réel plaisir à découvrir, dans un texte qui aurait certainement souffert d’une plus grande longueur. Grande maîtrise d’écriture qui dépasse largement le cadre d’un simple exercice de cohérence spéculative poussée à l’extrême.
Olaf Stapledon – Rien qu’un surhomme (1935)
Olaf Stapledon est présenté comme un génie méconnu de la science fiction d’entre deux guerres, à l’œuvre spéculative d’une portée réputée magistrale qui peut étonner aujourd’hui par son actualité ou son intemporalité comme par ses profondeurs de vues. L’admiration qu’il suscite rendrait sa lecture incontournable pour un amateur de science fiction éclectique.
J’avoue que cette lecture m’a profondément déçu.
Rien qu’un surhomme date terriblement par son écriture et son style, qui ne tient pas la comparaison un instant avec un contemporain comme, par exemple, Lovecraft qu’on peut lire aujourd’hui sans avoir en rien l’impression d’exhumer quelque chose qu’on va tout de même faire l’effort de lire par peur de rater un fond desservi par une forme vraiment vieillotte. Sans parler de H.G. Wells. Cette biographie imaginaire d’un surhomme à la recherche des siens qui essaie de fonder une société qui ne parviendra même pas au stade d’utopie n’atteint pas un vrai stade romanesque. Les problèmes moraux sont présentés de manière parfois grotesque, comme cette société primitive trop heureuse de se suicider entièrement pour laisser la place aux surhommes qui les ont partiellement subjugués ou hypnotisés. Il y a peut être une référence à Nietzsche dans le personnage que campe Stapledon, qui n’est pourtant guère Nietzschéen ni crédible. On appréciera d’autant plus la lecture de Nietzsche lui même.
Olaf Stapledon – Créateur d’étoiles (1937)
Créateur d’Etoiles est présenté comme le grand roman d’Olaf Stapledon, génie trop méconnu de la science fiction, avec une histoire du futur qu’il dépeint dans Les Derniers et les Premiers. Une influence perceptible des thèmes de cet ouvrage se retrouve dans un roman comme Eternité, de Greg Bear, ou sa Cité à la fin des temps. Ces deux grands romans spéculatifs et métaphysiques contiennent aussi une réflexion sur le devenir ultime de l’homme, de la civilisation et de l’intelligence.
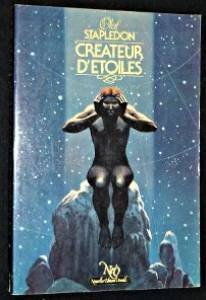
Mais Greg Bear ancre son œuvre dans l’origine profonde de la science fiction : l’utopie, la cité idéale, y compris dans les dimensions imaginaires de son architecture qui donne au lecteur à rêver et voyager en même temps qu’il a matière à réfléchir. Créateur d’Etoiles ne choisit pas cette approche, et ne choisit pas non plus une forme réellement romanesque puisque rien n’est véritablement raconté dans cette histoire de l’Univers. Rare ouvrage de science fiction qui ne se contente pas du cadre de notre galaxie ni même celui de notre voisine Andromède, Créateur d’Etoiles choisit d’embrasser toutes les galaxies en procédant à une distension de l’esprit du personnage principal qui perd explicitement toute individualité comme toute personnalité. Jamais le moindre élément n’éclaire ce qui peut bien arriver à cet homme qui sort de chez lui, un soir, pour regarder les étoiles. Fin du récit, page 5.
L’inquiétude religieuse est présente à chaque chapitre de cette fresque d’une ampleur indépassable puisqu’elle prétend tout rassembler, y compris la vie des étoiles qui finissent, en tant qu’être conscients, par danser un ballet à la gloire d’un improbable créateur. Tellement occupé par ses créations multiples, dans quel univers ce Créateur peut-il a son tour bien vivre, et que peut-il bien faire entre deux créations, pour se distraire, ce qui déplace le problème de manière peut être inconvenante, voir Spinoziste… Au delà d’une vraisemblance au moins minimale qu’on attendrait dans une œuvre à la portée cosmologique (c’est à dire scientifique), ce texte présente peut être un intérêt poétique par la naïveté de son questionnement religieux. Je ne l’ai personnellement pas perçu, mais je demeure admiratif devant l’œuvre de Greg Bear qui est allé y chercher des influences. Espérons qu’elle ne vieillisse pas aussi mal que celle de Stapledon.
Robert Charles Wilson – Les Derniers Jours du Paradis (2013)
La vie est omniprésente dans l’univers, elle se propage à travers les systèmes planétaires au moyen d’organismes tels des spores qui essaiment sur des mondes variés, Cette théorie de la panspermie est très différente de ce qu’a exploré jusqu’ici Robert Charles Wilson dans sa célèbre trilogie Spin – Axis – Vortex, où l’univers est peuplé de machines qui le colonisent selon une échelle temporelle, des finalités et des modes d’expansion qui nous échappent totalement.
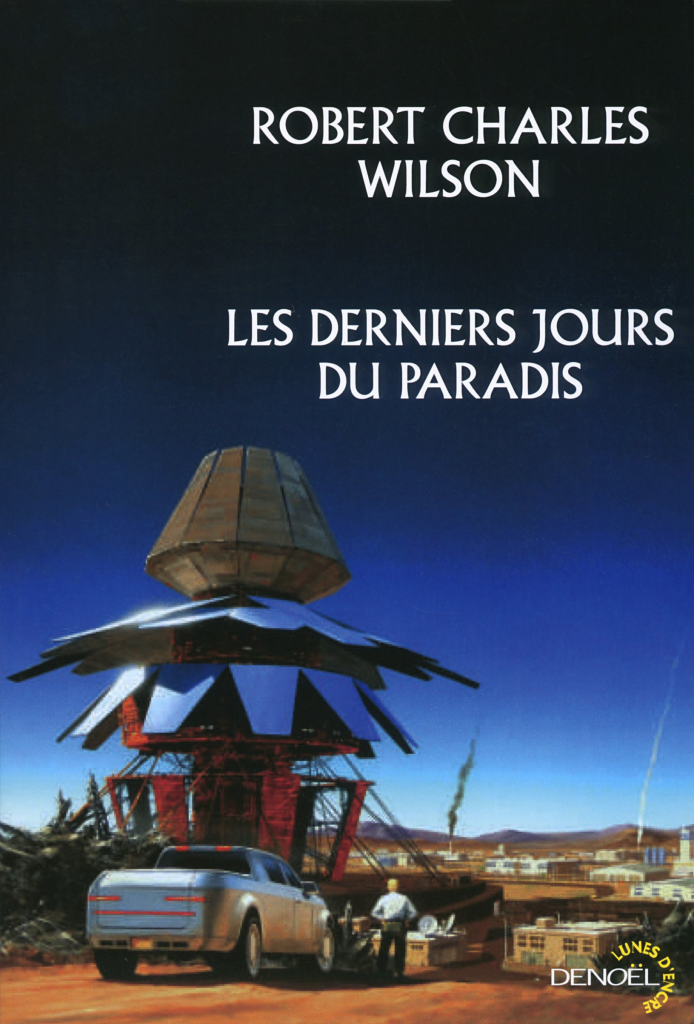
Les Derniers Jours du Paradis nous propose une uchronie très curieuse laissant une large part à la notion de réseau et de progrès technique contrôlé et surveillé à l’insu de l’humanité. Cette conspiration planétaire est découverte par les personnages du roman dans un long voyage où sont articulés découverte de soi et découverte d’un monde qui, pour être proche du nôtre, n’en est pas moins fort différent, car le cours de l’histoire a divergé de la nôtre depuis plusieurs siècles. Robert Charles Wilson reprend ici des thèmes classiques, tels l’idée que tout est contrôlé par des envahisseurs qui sont déjà omniprésents dans notre vie quotidienne. Nous pouvons découvrir leur omniprésence au travers de craquements et de fissures du quotidien qui remettent en cause notre propre existence désormais vouée à un combat difficile. On pense à la célèbre série Les Envahisseurs, à ceci près que la nature de ceux-ci s’avérera très surprenante, dans la continuité d’une œuvre littéraire centrée sur l’idée que, machines ou êtres vivants, les extraterrestres seront totalement différents de nous comme de petits hommes verts en soucoupe volante.
Ainsi Cassie, un des personnages principaux, n’arrive pas à dormir la veille de la commémoration d’un siècle de paix depuis l’armistice de 1914. Elle remarque qu’un homme l’observe depuis la rue, en bas, et se fait écraser par un chauffard. Mais le cadavre n’est pas humain, et que ce qui a tué ses parents il y a sept ans est en train de recommencer. Alors commence une longue, très longue traque…
Ce roman n’est peut être pas le meilleur de Robert Charles Wilson, mais il s’inscrit très bien dans la continuité de son œuvre et séduira les amateurs d’autres textes plus ambitieux.
Robert Charles Wilson – Les Perseides (2000)
On attend d’une œuvre littéraire la cohérence, souvent à travers des centaines de pages qui doivent établir un univers stable et des intrigues exploitées dans leurs croisements mutuels comme dans leurs conséquences ultimes, formant la profonde unité d’un récit. Au contraire, un recueil de nouvelles peut nous présenter des facettes très différentes d’un même écrivain, sans qu’il y ait lieu de chercher d’autre unité que la diversité d’une même personne. Un joyau beaucoup plus rare consiste en un ensemble de nouvelles qui explorent le même thème, différentes occurrences d’échos divergents qui pourtant parlent de la même chose et finissent par raconter une même histoire, mais avec une multitude de points de vue dont les incohérences renforcent précisément le sentiment de cohésion de l’ensemble : il y a là une seule et même histoire, qui m’est racontée de tellement de manières et de points de vue que je ne dispose que de points d’entrée dans un kaléidoscope derrière lequel se trouve une unité dont je n’ai qu’une vue partielle. Pour cette raison, un tel texte persiste à habiter son lecteur longtemps après la lecture, comme des vues un monde plus riche que ce qui a été montré. Le monde de Zothique de Clark Ashton Smith est un exemple de cette matrice d’imaginaire.
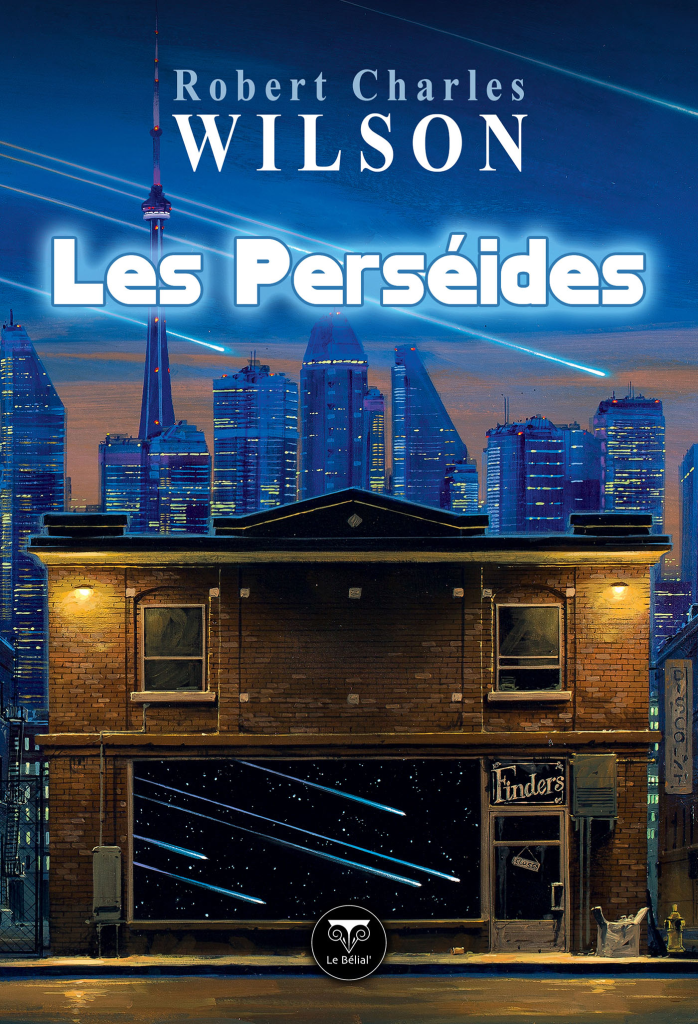
Robert Charles Wilson nous livre ici un trésor très différent de ses textes habituels. Tout comence par un récit fantastique à la Dickens mettant en scène un lieu de plus en plus rare, qui devrait concerner tout lecteur de livres bizarres comme la SF : une librairie, son libraire, ses livres, les histoires qu’il raconte, et les dangers de la porte à l’arrière de la boutique. Puis se multiplient les personnages pour chacune des nombreuses nouvelles d’une science fiction très inhabituelle. Vient ensuite le retour d’une libraire, le regard en arrière sur les années 70 et ses survivants, par exemple à Toronto, et d’autres choses encore. En refermant ce volume, on a l’impression d’avoir soulevé le coin d’un voile secret, d’un univers mystérieux qui se continue, derrière la porte, ou au sous sol, ou bien là où regardait le télescope de Edwin Hubble, « qui avait jeté un coup d’œil dans la plus ancienne histoire du ciel ». Sans oublier les chats.
Prolonger Spin n’a peut être pas été la meilleure idée, mais ce recueil ne peut, lui, guère être prolongé : l’essentiel s’est déjà inscrit de lui même dans l’imaginaire du lecteur. Absolu chef d’œuvre.
Connie Willis – Le Grand Livre (1993)
Au commencement de ce livre, on a du mal à comprendre pourquoi il a été récompensé par le prix Hugo 1993. Il s’agit de voyage dans le temps. L’université d’Oxford en a la charge. On se doute bien que le voyage de la jeune historienne Kivrin Engle juste avant l’épidémie de peste noire se passera mal. On sait d’emblée que le passé n’est pas modifiable et qu’on n’aura donc pas de complexes paradoxes temporels. Les enjeux semblent d’autant plus restreints qu’il ne semble pas qu’on ira bien plus loin qu’un minuscule village dans la campagne anglaise du XIV° siècle.

Cependant une épidémie mystérieuse se déclare dans le présent, redoublée de problèmes administratifs et de lutte d’influences au sein de l’université dont l’ampleur confine à un comique savamment entretenu au long d’une histoire très bien menée au fur et à mesure qu’on se laisse gagner par la narration et que l’on découvre des personnages attachants. Et petit à petit, ce va et vient entre deux épidémies prend de plus en plus corps alors que l’histoire devient de moins en moins comique ; s’il peut y avoir une fin « heureuse » pour que le gentil professeur récupère la jeune étudiante dans un passé lointain, cette histoire laissera des traces très profondes dans la vie et la personne de cette jeune femme confrontée à la peste et à la manière dont les humains vivent cette mort omniprésente, qui progressivement envahit tout ce monde hivernal. Les enjeux humains transcendent ceux du voyage dans le temps de manière brillante, qu’ils passent par la mesquinerie, la méchanceté, l’innocence de l’enfance ou la grandeur morale admirable d’un banal curé de village.
Une histoire remarquablement menée par Connie Willis, mise en scène de personnages qui gagnent profondeur et réalisme au delà d’une banale histoire de voyage dans le temps. Un roman émouvant qui laissera difficilement indifférent, sans une ligne en trop malgré sa longueur apparente.
Jack Mc Devitt – Seeker (2005)
L’archéologie spatiale est un des grands thèmes de la science fiction : elle est le péché mignon du Capitaine Jean Luc Picard, elle inaugure des romans majeurs comme Un feu sur l’abîme de Vernor Vinge. La fascination pour un passé immémorial et une sagesse mystérieuse cachée derrière des prodiges technologiques qui nous dépassent fondent des textes aussi classiques que Rendez vous avec Rama.
Cependant, on attend de la science fiction qu’elle soit toujours métaphore du présent et non simple décalque de notre quotidien avec quelques éléments technologiques tellement habituels et convenus qu’aujourd’hui, un simple frigidaire connecté recèle peut être plus de possibilités imaginaires qu’un vaisseau spatial, selon la manière dont il est mis en scène. Peut-on encore parler de science fiction dans le cadre d’une stricte enquête policière menée par des archéologues motivés par le seul appat du gain? On attend de reliques du voyage spatial un frisson qui rappelle au moins confusément celui que nous procure le Nostromo ou les reliques que son équipage explore au début de ce monument cinématographique, Alien. Un « simple » amoncellement de cadavres dans une vieille carcasse métallique, même très grande, demeure nettement moins stimulante…
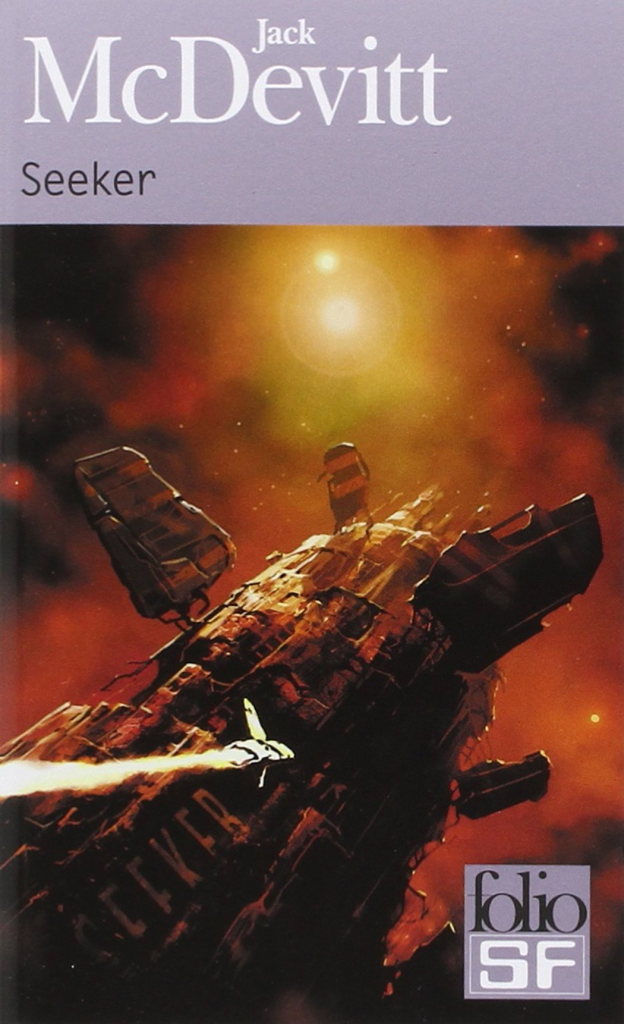
Certes, Jack Mc Devitt sait nous raconter une histoire et nous tenir en haleine avec une colonie perdue qui a cherché, il y a bien longtemps, à fuir le cours de l’histoire de l’humanité. Il sait également faire rebondir son intrigue au delà de la découverte d’une épave qui n’a hélas rien de très exaltant… Cependant, il ne semble pas que cet univers, très éloigné dans le temps et l’espace mais qui ne se distingue quasiment en rien du nôtre, soit de nature à susciter l’exaltation ou même l’émotion des amateurs d’archéologie spatiale. Les quêtes de l’El Dorado dans la jungle amazonienne qui peuvent encore, parfois, révéler quelques surprises au contraire de ce texte dont même les personnages manquent de relief comme de profondeur à force de vouloir être calqués sur la banalité de notre quotidien.
Gregory Benford – Le Cycle du Centre Galactique (1976 – 1996)
La durée des voyages spatiaux rend difficile le contact avec une espèce vivante extraterrestre, c’est pourquoi il est plus vraisemblable que nous entrions en contact avec des machines lancées dans un tel voyage. Pourquoi de telles machines seraient-elles sympathiques ? Auront-elles supplanté leurs créateurs, comme nous l’évoquent de nombreuses spéculations ? Bien avant Spin de Robert Charles Wilson, le cycle du centre galactique de Gregory Benford explore longuement ce thème. Il se compose de 6 volumes, les deux premiers se suivant de près (Dans l’Océan de la nuit et A Travers la mer des Soleils), les trois suivants relatant une seule et même histoire très différente (La Grande Rivière du Ciel, Marées de Lumière et Les Profondeurs Furieuses). Le dernier volume, Sailing Bright Eternity, rassemble et tente de conclure toute cette vaste histoire (non traduit en français).

Les deux premiers tomes nous dépeignent la difficile rencontre entre l’humanité et les « extraterrestres », l’ennemi qui hante tout le cycle : les machines, dont le règne est à l’échelle de la galaxie. Le scientifique et astronaute Nigel Walmsley souffre d’une sympathique incapacité à se plier aux ordres d’une quelconque hiérarchie. Tout commence par la rencontre d’un mystérieux astéroïde dans notre système solaire, dans un futur très proche. Au commandes d’un vaisseau ayant pour mission de détruire cet intrus, Walmsley choisit de désobéir pour l’étudier, alors qu’il menace la Terre : il s’agit en fait d’un immense vaisseau spatial abandonné dont l’exploration réjouira les amateurs d’archéologie spatiale. Son choix provoquera la venue d’un second vaisseau et la découverte de quelque chose de très étrange sur la Lune, qui donnera à l’humanité les clefs du voyage interstellaire. Walmsley embarquera ainsi dans le premier vaisseau humain en route vers un autre système planétaire abritant certainement l’intelligence. Il aura auparavant eu l’occasion de dialoguer avec une intelligence étrangère qui lui exposera une des clefs de la supériorité de la vie : l’accès au monde des essences, sur lequel tout le mystère demeure. Toutefois, des êtres mystérieux faits d’énergie apparaîtront au cours des romans suivants, tissant entre ces histoires un lien étrange et ténu.
Les choix parfois hasardeux et toujours aventureux de Walmsly s’avéreront pertinents, mais l’humanité se retrouve en très grand danger dans le second volume. L’idée de coloniser notre planète en commençant par les océans permet de se démarquer des apocalypses mécaniques et invasions de vaisseaux, de la Guerre des mondes à Terminator. A la fin du second volume, on attend impatiemment les suites des découvertes des explorateurs sur un monde très lointain, sans possibilité de retour sur Terre, après avoir rencontré une espèce intelligente réduite à une quasi animalité. Que peuvent bien faire les machines avec les pulsars près du centre galactique ? On dispose d’une carte et d’un vaisseau…
Les trois volumes suivants dépeignent un un tout autre univers, très très loin dans l’avenir et l’espace. Les hommes se sont beaucoup transformés et ne peuvent survivre dans un univers particulièrement hostile qu’au moyen d’implants divers : exosquelettes, communicateurs, implants cérébraux de personnalités défuntes plus ou moins conscientes et par là plus ou moins parasites. Il y a bien un cyberpunk de la barbarie ; le déclin de la civilisation est impressionnant et ravira les amateurs d’univers post apocalyptiques, y compris dans la violence pour la survie. Qu’en coûterait-il pour que nous perdions quasiment toute notion d’astronomie ou de mathématiques, pour en revenir à un nomadisme de chasse et de cueillette avec des armes et équipements qui témoignent de la déchéance de l’humanité ? Ces romans nous en donnent une idée.
Le premier volume de cette trilogie décrit la survie sur une planète où les machines ont triomphé de la civilisation humaine. Le regard ethnologique de Gregory Benford approfondit cette société redevenue très primitive, qui n’a aucune idée de ce que peuvent signifier les initiales NW sur un étrange édifice oublié, de même qu’elle n’a aucune connaissance de ce que peut bien être le jeu d’échecs d’où viennent les noms des Familles auxquels ils se rattachent. Tout renvoie le lecteur à un monde perdu dont il n’a pas les clefs, de très rares bribes d’histoire étant dévoilés au fil d’une intrigue qui ramènera la Famille de Kileen, le personnage principal, aux commandes d’un vaisseau spatial après avoir cru triompher d’une vaste et maléfique intelligence artificielle. Un monde aussi cauchemardesque mériterait certainement une adaptation à l’écran si des séries comme « the 100 » trouvent un public.

Les aventures de Kileen se poursuivent dans les deux volumes suivants, d’abord avec la rencontre mouvementée d’une espèce vivante ayant poursuivi très loin la fusion avec la machine, cyborgs démesurés qui sont peut être parents de cette espèce déchue du second volume du cycle. Le voyage vers le centre galactique se poursuit, et finit par amener Kileen quelque part au terme d’une très longue errance, près du trou noir au centre de la galaxie. Les spéculations scientifiques de Gregory Benford en viennent à être difficiles à suivre, mais n’ont plus guère de pertinence dans le monde imaginaire très curieux qui clôt cette trilogie et annonce la rencontre de ses deux parties : il va enfin se passer réellement quelque chose.
L’intrigue de chacun de ces romans est fort bien menée, le souci de vraisemblance qui préside à la construction de ce vaste univers lui donne son originalité (aucun vaisseau ne voyage plus vite que la lumière, mais on aura du mal à admettre qu’il puisse y avoir des formes de vie faites de lumière et d’énergie en plein vide cosmique ou au voisinage immédiat des étoiles…). La méditation sur la place de la machine et ses dangers dans l’édification de la civilisation du futur est intéressante bien qu’assez traditionnelle, y compris dans le portrait que nous trace Gregory Benford d’un homme de l’avenir dont la chair intègre nombre d’améliorations technologiques mais aussi génétiques. Cependant, on regrettera peut être que l’auteur ne parvienne pas à nous mettre en présence plus rapidement d’un univers qui gagnerait peut être en ampleur par une narration plus resserrée.
Yves Potin (2015)

