L’imagination vit de la recherche des atmosphères, ambiances et climats que l’on trouve dans la musique comme dans n’importe quel art – quel intérêt présenterait une expression créatrice si elle ne stimulait pas l’imagination, l’évasion, la recherche d’un ailleurs ou d’un au-delà de la trivialité, de la routine quotidienne et de ses médiocrités ? Cet article présente par quelques romans fantastiques des pistes et sentiers de voyage, d’exploration intérieure, découvertes et spéculations prospectives et utopiques sur les lignes de fuite de ce que le présent recèle déjà, ou manières de s’en détourner par les fenêtres ou portails qu’ouvre la création littéraire.
Il s’agit ici de présentations, de simples regards et indications, notes de lecture organisées en deux thématiques : spéculations et métaphores du présent, rassemblées dans la catégorie de la science fiction, ou chemins de l’ailleurs et de l’au delà dans les univers du fantastique et de la fantasy.
- Donald Wandrei – Cimetière de l’effroi
- Peter Clines – 14
- Caitlin R. Kiernan – La fille qui se noie
- Guy Gavriel Kay – La tapisserie de Fionavar
- Richard Matheson – D’autres Royaumes
- Neil Gaiman – L’Océan au bout du Chemin
Donald Wandrei – Cimetière de l’effroi (1948)
Quel est le besoin d’aller traîner dans le vieux cimetière quand on est enfant, alors que c’est absolument interdit, surtout pour en ramener une statuette qui semblait attendre juste qu’on la tire du sol ? Mais comment une bêtise d’enfant pourrait-elle causer la mort de la famille ? Un adulte qui passe lui aussi son temps à fouiller les cimetières, c’est à dire un archéologue, va se rendre compte qu’il y a là quelque chose de tout à fait anormal et entreprendra un très long voyage à la poursuite de cette statuette qui ne le laissera pas intact…

Ce roman fut publié en France comme numéro 1 de la série Angoisse du Fleuve Noir, puis fut réédité dans les années 80 dans la collection Néo, elle même aujourd’hui très appréciée des collectionneurs et dont certains titres sont devenus très rares, comme la première édition presque intégrale en français de l’oeuvre de Clark Ashton Smith. Le roman de Donald Wandrei constitue lui aussi un titre qui s’inscrit dans la tradition Lovecraftienne, dont Smith fut un grand inspirateur. Ce roman manifeste une maîtrise poussée des procédés de suspense du roman d’horreur en dépassant largement ses cadres. Si de nombreux textes de la collection Néo peuvent aujourd’hui sembler très datés voire franchement inégaux (par exemple la pléthore des romans et recueils de Robert Howard), Cimetière de l’effroi, au-delà de son titre racoleur, nous plonge tout de suite dans une intrigue qui se démarque de nombreux textes d’inspiration Lovecraftienne, souvent tous un peu semblables lorsqu’on a fréquenté August Derleth. Si le fantastique se caractérise par l’absence d’explication rationnelle des phénomènes qu’il met en scène, et bien souvent par l’utilisation de puissances et entités immatérielles (à commencer par les traditionnelles histoires de fantômes), que nous donne ici Donald Wandrei ? Reprenant la tradition du Maître de Providence, nous sommes mis en présence d’une horreur qui ne se laisse pas penser selon les critères du surnaturel ou de l’inexplicable, au terme d’un récit qui fascine par les abîmes de temps, d’espace et d’étrangeté ouverts devant le lecteur. Fantastique ? Science fiction ? Ce roman sait faire éclater les genres, en particulier par sa brillante et surprenante conclusion, et semble en mesure de surmonter l’épreuve du temps… Mais peut être pas autant que ce vieux cimetière qui coupe mystérieusement une voie pavée très ancienne, peut être romaine, dans les collines désolées de la campagne anglaise…
Peter Clines – 14 (2012)
Que peut-il bien se passer chez les voisins ? Déjà, qui sont-ils ? Que cachent-ils derrière leur porte close, et que cache cette porte 14 que nul n’a jamais vue ouverte dans ce petit immeuble si commun ? Et si, déjà, on commençait par descendre à la cave ? L’auteur révèle un vrai talent de conteur pour distiller une telle étrangeté, une telle fascination pour un quotidien qui cesse peu à peu d’être d’une navrante banalité. Nous pouvons tous le souhaiter : découvrir le mystère, l’inexplicable et aussi le sentiment croissant du danger derrière la porte close de l’étage d’en dessous, dans la lecture du règlement, dans la simple manière de payer le loyer, ou encore dans la personne tout à fait banale de quelqu’un qui passe pourtant toutes ses journées à surveiller l’immeuble.

Comment faire peur au lecteur et susciter le suspense, écrire un roman qu’on ne lâche pas des mains même si l’on sait, à force de lectures, que tous ces éléments, détails et procédés, on les a déjà lus, vus et rencontrés dans de multiples textes, assez blasé des procédés du roman à suspense ? La « réponse » s’appelle peut être le talent : reprendre de nombreux détails d’un quotidien ou s’immisce le mystère, qui est d’abord celui de la porte close des appartements voisins d’un domicile où l’on vient d’emménager. Le fantastique, c’est traditionnellement la maison fantastique. Elle peut certainement être une métaphore de l’âme du personnage romanesque habité par l’horreur et la folie, mais ici le fantastique habite les voisins, une maison un peu bizarre et des gens qui le sont aussi parce qu’ils sont inconnus. Qu’y a-t-il derrière la porte 14 qu’on ne doit pas ouvrir ?
La trivialité de ces éléments narratifs peut faire croire au procédé littéraire facile d’un roman de gare, mais réussir un bon roman comporte toute une alchimie qui ne se laisse pas enfermer dans une recette, pas plus que le plaisir de lire un bon roman à suspense ne se laisse exprimer par les descriptions qu’on peut donner de son histoire. Peter Clines sait faire monter très progressivement les enjeux de son récit et de l’enquête dans laquelle ses personnages ne peuvent s’empêcher de s’investir et s’impliquer toujours plus profondément . L’idée de Scooby Doo au pays de Cthulhu peut prêter a sourire (déjà, il n’y a pas vraiment de chien comme mascotte de l’équipe de ce roman, pas plus qu’il n’ y a de tentacule derrière la porte 14). Mais il n’y a pas non plus de vraie peur, de vrai danger dans la vie de ces gentils personnages de dessin animé, au contraire de ce roman dont les méchants font bien autre chose que de mettre un costume pour effrayer le voisinage. Si ses personnages peuvent naïvement croire qu’ils sont lancés dans une enquête inoffensive qui ne changera rien à leur vie, la subtile montée des dangers et des découvertes de ce qui se cache derrière cet immeuble révèle d’un auteur capable d’inscrire brillamment une histoire faussement banale dans une tradition de littérature fantastique renouvelée de manière surprenante.
Caitlin R. Kiernan – La fille qui se noie (2012)
La littérature fantastique connaît deux tendances, deux manières d’aborder l’intériorité : la plus connue et répandue est celle de la hantise surnaturelle où des êtres de l’au delà cherchent des formes de manifestation à travers des lieux ou des personnes, la classique maison hantée étant bien souvent une métaphore de l’esprit même du personnage principal dont la possession est l’enjeu central du récit. D’autre part, une telle possession et les phénomènes apparemment surnaturels qu’elle projette peuvent aussi exprimer la maladie mentale, aux puissants ressorts narratifs et imaginaires, des romans de Henry James au remarquable film Shutter Island, et aux métamorphoses de Psychose à Bates Motel. Rares sont les rencontres entre ces deux écoles, l’une « métaphysique » et l’autre clairement psychologique. Le roman de Cailtin Kiernan en est un exemple particulièrement brillant, forme d’OVNI littéraire de nature à combler les lecteurs les plus blasés d’histoires d’horreur comme les amateurs, peut être plus exigeants, des explorations intérieures tourmentées.

Car il est clair dès le départ que la narratrice est folle, elle le déclare elle même spontanément dès les premières pages. Son journal fait éclater l’histoire entre une multitude de possibles, lire un tel texte est une plongée dans les abysses d’une psyché malade à laquelle il semble pourtant bien qu’il arrive quelque chose de réel et non simplement une série d’états hallucinatoires. Il y a bien quelqu’un qui est passé, une nuit, dans l’appartement. Il y a un témoin. Ensuite… La maladie mentale peut-elle vraiment rencontrer le surnaturel, la narratrice est-elle vraiment possédée par autre chose que ses propres démons et idées fixes ? Tout serait explicable sans ces éléments proprement terrifiants qui jalonnent le récit et le rendent haletant, sans aucune magie, aventure, ou incantation : l’horreur dans une galerie de peinture, lors d’une après midi ensoleillée. Un tableau peut-il être hanté ? S’est-il vraiment passé quelque chose, et quoi, au-delà des multiples versions contradictoires et intriquées d’une rencontre en auto stop, la nuit ?
La narratrice, véritable sujet de ce texte magistral, se révèle particulièrement émouvante et réaliste, extraordinaire construction qui prend corps au fil des lignes dans toute la démesure et l’irrationalité de sa personnalité, dans les méandres d’une sexualité dont la peinture n’est jamais voyeurisme facile ou pornographie tapageuse, mais profonde sincérité. Au travers de tous les dangers et épreuves intérieures, dans un roman qui laisse subsister, toujours, le plus profond doute qui est au cœur de tout bon roman fantastique, on ne cesse de se demander : qu’était-ce ? Y-a-t-il vraiment eu quelque chose, même si je ne pourrais jamais l’expliquer ? Réalité ou folie ? Même à ce niveau, le lecteur est porté à croire les choses les plus contradictoires, dans un roman aussi difficile à lâcher qu’une idée fixe et obsédante, forme de hantise de l’esprit…
Guy Gavriel Kay – La tapisserie de Fionavar (1984 – 1986)
« Le génie est celui qui donne ses règles à l’art » disait le Grand Sage de Königsberg. Ainsi peuvent fleurir les pâles imitateurs des rares esprits éclairés dont l’œuvre, parfois bien brève, fait jaillir un style, un courant, une école. Ainsi en va-t-il de Tolkien, tellement imité, qui est allé chercher aux sources de notre imaginaire des archétypes qu’il suffit aujourd’hui de reprendre et de combiner pour générer des histoires sans grand intérêt ni originalité. Tout rayonnage de science fiction en librairie ces dernières années a été colonisé par de tels écrits, au milieu d’histoires de vampires et d’invasions de zombies. On peut aussi chercher à se démarquer du Maître en projetant les fantasmes faciles et très commerciaux de la violence la plus débridée et malsaine qui n’a plus rien de cathartique, sous le prétexte d’enjeux politiques qui ont beaucoup de mal à rendre présents le mythe et les profondeurs de l’imaginaire, dans la tradition que poursuivait Tolkien depuis Homère.
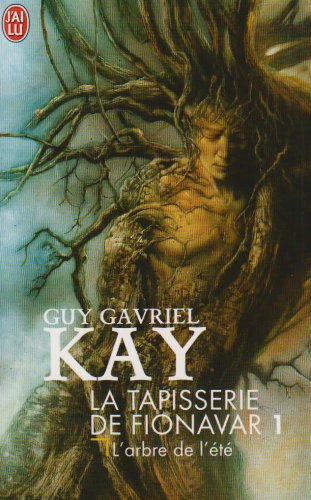
Y a-t-il une fantasy qui vaille vraiment la peine d’être lue depuis Tolkien ? La trilogie de Fionavar, de Guy Gavriel Kay, indéniablement poursuit et renouvelle le genre et donne à lire une histoire merveilleusement contée, palpitante, profonde et réellement émouvante, qui nous confronte à la profondeur du mythe et à la réalité du rêve.
Continuité, car il y a bien un monde médiéval, des chevaliers, des princesses, des épées, des forêts mystérieuses, des sorciers dans leurs tours, d’anciens lieux habités par d’étranges créatures dans de profondes forêts, et même des elfes qui ne disent pas leur nom, toujours aussi peu amateurs du commerce avec les nains. On trouve même à la racine de l’histoire l’essence du mal qui est libérée et cherche à étendre sa noirceur.
Renouvellement surtout, qui donne à cette trilogie tout son intérêt. L’histoire commence dans notre monde, avec les Cinq, au commencement étudiants à l’université de Toronto, qui se laissent entraîner par une vraie magie, pratiquée par un vrai magicien, dans un monde étrange, la racine de tous les mondes, l’ultime réalité, celle des rêves et des mythes qui existent bel et bien : Fionavar. Tous les destins sont liés comme les fils d’une tapisserie, qui entrecroise les vies au delà de tout hasard. Mais est-ce bien un destin ? Les trois romans mettent en scène la liberté, le poids des actes de chacun des Cinq sur le cours des choses et du monde qu’ils doivent peut être sauver à défaut d’y être sacrifiés. Au centre, le rôle du libre arbitre dans la continuité d’une histoire très, très ancienne, de lieux et de magies bien présentes qui agissent sur le cours des choses.
Mais la révolution la plus significative que sait introduire Guy Gavriel Kay dans un roman de fantasy consiste en la place qu’il donne aux femmes. Elles peuvent être des princesses, des amantes ou des magiciennes, ou un peu tout cela à la fois, elles n’en sont pas moins complètement actives, qu’elles fassent partie des Cinq ou soient des figures majeures du monde de Fionavar. Leur personnalité est forte, affirmée, leurs actes pleins de sens et d’importance dans cette grande méditation sur la liberté, leurs évolutions et transformations tiennent une place de premier plan sans que l’auteur les transforme en amazones furieuses ou en courtisanes intrigantes derrière des rois vieillissants. S’il a fallu créer de toutes pièces un rôle féminin dans l’adaptation à l’écran de Bilbo le Hobbit, la Tapisserie est au contraire un univers qui sait conférer à la femme une vraie place, révolutionnant ainsi ce genre littéraire tout en assumant sa continuité dans des romans qu’on a du mal à quitter. Au delà de la complexité des 50 premières pages qui posent un univers extrêmement riche et foisonnant, ces trois livres habiteront longtemps leur lecteur par les échos des archétypes qu’il savent trouver en nous, dans la continuité de l’univers des Terres du Milieu.
Richard Matheson – D’autres Royaumes (2011)
Ce roman est l’avant dernier d’un des grands écrivains de fantastique mais aussi de science fiction du vingtième siècle, décédé en 2013. Connu pour son roman Je suis une légende adapté de nombreuses fois au cinema, M. Matheson nous donne au soir de sa carrière une histoire attachante merveilleusement contée, aux éléments certes très classiques : Alex White, vétéran de la première guerre mondiale, s’installe dans le village d’un de ses compagnons d’armes mort dans les tranchées, pour découvrir que ce village comme son ami ont un secret, la porte de ce que certains appellent le Petit Peuple et d’autres les Elfes. White habite une maison apparemment hantée et choisit de s’aventurer dans des sentiers de forêts qu’on lui a pourtant dit de ne pas prendre. Il en sera sauvé par une femme étrange : fée ou sorcière ?
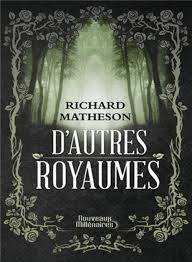
Dans tout le récit, le narrateur conduit une interrogation sur son propre style – son parcours lui a permis une carrière littéraire ultérieure, mais comment est-il sorti de ces Autres Royaumes ? On s’interroge en parallèle sur la portée de ce retour sur lui même d’un écrivain : est-ce Matheson lui même qui s’interroge sur son écriture et nous en dévoile quelques secrets, ou en tout cas les éléments d’une autocritique très précise sur les éléments d’un style d’écriture ? Comment construire de belles phrases, à travers des exemples de quelques mauvaises, bien soulignées ?
Une histoire qui se laisse lire avec beaucoup de plaisir, oeuvre d’un très grand Monsieur du fantastique du siècle passé.
Neil Gaiman – L’Océan au bout du Chemin (2013)
Il y a en toute enfance une arrière cour, un chemin ou un sentier plein de mystères, lieu interdit ou secret, et la maison d’amis où il était très rare de pouvoir pénétrer. Ou une fillette étrange pour qui la mare au bout du chemin est un océan. Ensuite se termine l’enfance et commence l’oubli, sous la pression de choses plus importantes et urgentes qui font la vie. Des couches successives viennent ainsi se sédimenter au dessus de souvenirs qui pourtant continuent parfois de hanter et tourmenter une personnalité, comme s’ils pouvaient être bien plus importants que tout le reste – et ils le sont parfois.
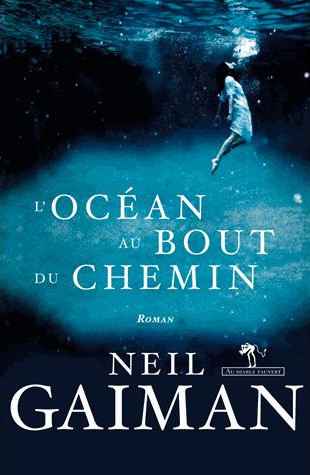
Quoi de plus important – et étrange – qu’un locataire dans la maison familiale ? Quoi de plus dérangeant qu’une gouvernante qui s’impose dans la famille, surtout si elle n’est qu’un monstre qui habite les rêves de l’enfance, peuplés par ces étranges femmes de la maison au bout de la ruelle ?
Neal Gaiman nous propose ici un renouvellement des créatures fantastiques qui s’enracine profondément dans l’imaginaire des fées et sorcières pour le transformer d’une manière saisissante, car l’imaginaire de ce qu’il y a au bout de la rue ou du chemin demeure tellement personnel qu’il nous a fait nous mêmes, bien que nous en arrivons à l’oublier. L’auteur parvient à introduire ou plutôt restaurer un contenu émotionnel et imaginaire dans les choses les plus anodines, son texte réactivant un étonnement, un émerveillement tout au fond de nous qui nous a construit, comme ce gros chat gris qui contemple le monde.
Un renouveau profond profond de la littérature fantastique comme Neal Gaiman nous y habitue.
Yves Potin (2015)

